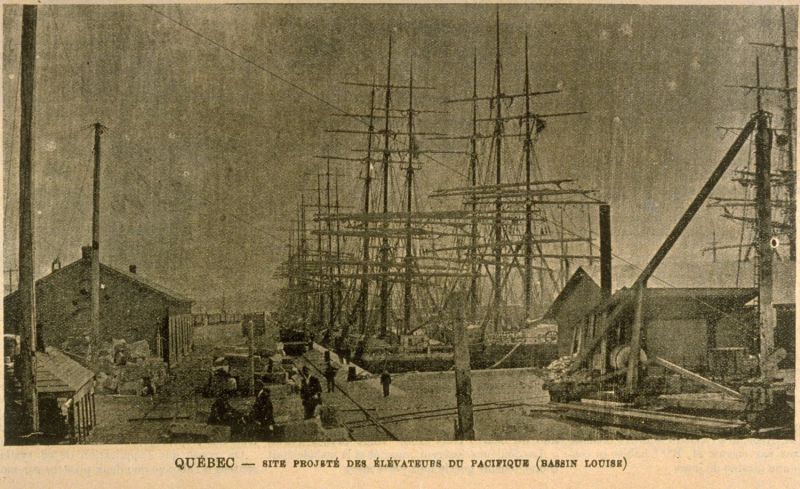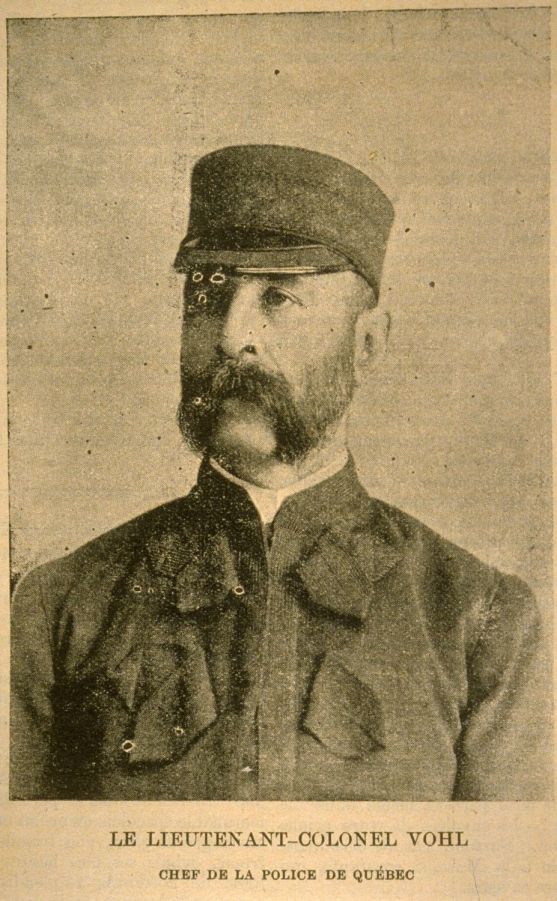Hier soir, j’ai eu la chance exceptionnelle de prendre part à une soirée au Château Frontenac visant à relancer les activités de la Chaîne des rôtisseurs, bailliage de Québec. Bon, je sais: pour la majorité des gens, ce nom évoque un certain resto livrant du poulet… Mais en fait, il s’agit d’une confrérie gastronomique dont les racines remontent littéralement au Moyen Âge français! Si le Québec a une tradition épicurienne beaucoup plus récente, il est quand même intéressant d’examiner l’histoire de ces regroupements d’amoureux de la bonne table* dans la Belle Province. Ça titille votre intérêt? Suivez-moi!
* Je n’aborderai pas ici les confréries de vin, car c’est une toute autre histoire… dont je compte bien m’occuper plus tard!
La Chaîne des rôtisseurs

Cuisiniers préparant de la viande. Gravure sur bois de Buglhat et Hucher, 1549. (Je n’ai pas acquis les droits sur l’image, d’où le filigrane…)
Basée à Paris, la Chaîne des Rôtisseurs est une Association Internationale de la Gastronomie. Elle est l’héritière de l’ancienne corporation des rôtisseurs d’oie de Paris, érigée pendant le règne de Louis IX dit saint Louis. Selon certaines sources, cette corporation aurait été officialisée en 1248 (j’admets ne pas avoir trouvé grand chose à ce sujet).
En revanche, le Livre des métiers rédigé vers 1260 par Étienne Boileau, prévôt de Paris, nous apprend que le rôtisseur est appelé cuisinier oyer ou simplement oyer, rôtisseur d’oies. Il faut dire qu’au 13e siècle, l’oie rôtie est le mets favori des riches Parisiens, incluant la Cour, alors même les rôtisseurs de d’autres viandes se qualifient d’oyer: c’est plus chic! Ces cuisiniers oyers avaient le monopole pour « trousser, parer, rôtir les volailles et le gibier à poil et à plumes, les agneaux et les chevreaux ». Ils préparaient aussi diverses viandes et charcuteries.
L’appartenance à cette sorte de guilde est assortie de règles strictes. En effet, les corporations servent à structurer et à codifier les métiers spécialisés en établissant, par exemple, certaines exigences liées au savoir-faire et à la qualité de ce qui est préparé. Nos cuisiniers oyeurs doivent donc conseiller à leurs acheteurs de ne plus consommer les viandes trois jours après l’achat. Ces pratiques encadrent donc le métier, en plus de veiller à la sécurité des consommateurs – très moderne, comme approche!
Au cours des siècles suivants, ces cuisiniers oyers se spécialisent de plus en plus comme cuisiniers tout court et comme traiteurs, tandis que le rôtissage lui-même tombe dans une sorte de flou juridique. Pour récupérer le monopole de la préparation de viandes et volailles rôties, un certain nombre de cuisiniers demandent au roi Louis XII la création d’une nouvelle profession, les rôtisseurs, ce qui est accordé en 1509.

Illustration métaphorique du métier de rôtisseur par Nicolas Larmessin, 1695. (Je n’ai pas acquis les droits sur l’image, d’où le filigrane…)
Éclipsée par la Révolution française, la corporation des rôtisseurs disparaît en 1793, en même temps que bien d’autres institutions royales.
Il faut attendre 1950 pour voir renaître un regroupement de rôtisseurs à Paris: grâce au travail de deux chefs et de trois gastronomes, on refonde cette ancienne association sous le nom de Chaîne des rôtisseurs.
Aujourd’hui implantée dans plus de 80 pays, cette confrérie compte environ 25 000 membres, des passionnés partageant les quatre valeurs primordiales, soit la qualité, la gastronomie, la promotion des arts culinaires et celle des plaisirs de la table. Si l’ancienne corporation rassemblait uniquement des artisans (bref, ceux qui «se mettaient les mains dedans» et cuisinaient), l’actuelle Chaîne des rôtisseurs rassemble certes des professionnels, qu’ils soient hôteliers, restaurateurs, chefs ou sommeliers, mais aussi des gourmands de tous milieux, des amateurs de bonne table… des épicuriens, quoi!
Les confréries de gastronomes au Québec
Transportons-nous maintenant de l’autre côté de l’Atlantique, au Québec.
Si Samuel de Champlain en personne fonde l’Ordre de Bon Temps à Port-Royal (bon, c’est en Acadie… mais tout de même) en 1606, dans le but de donner aux gentilshommes de sa suite l’envie de chasser et de cuisiner, cette initiative ne connaît malheureusement pas de suite. On tient de bonnes tables chez le gouverneur, l’intendant et quelques autres dignitaires de l’époque de la Nouvelle-France, mais on ne peut assurément pas parler de clubs gastronomiques!
Les gentlemen’s clubs qui apparaîtront à la faveur du Régime anglais ne peuvent pas davantage être considérés comme des associations de gastronomes : on y mange, boit, discute de politique, fume et joue au billard, sans véritable accent sur la nourriture et l’art de la table.
C’est vraiment au 20e siècle qu’apparaissent les premiers regroupements de gastronomes.
La toute première confrérie d’amateurs de bonne chère au Québec semble être le Club Prosper Montagné. Créé à Paris en 1950, le chapitre canadien est fondé à Montréal à peine quatre ans plus tard, en 1954. Notons que Prosper Montagné était un chef français réputé, qui a notamment créé le Larousse gastronomique (1938), l’encyclopédie de base de la gastronomie française.
Ce premier club en entraîne d’autres. Les Amis d’Escoffier est une autre confrérie fondée à Montréal en 1955, bientôt suivie de la confrérie des Compagnons de la bonne table, qui voit le jour à Montréal le jeudi 9 avril 1959. L’article de la Presse qui en fait état révèle que les compagnons, au nombre de quarante, sont tous membres du conseil d’administration de l’Association des hôteliers de la province de Québec. Ils se voient alors accorder le privilège exclusif d’arborer au cou la chaîne d’argent écussonnée de la marmite de fer et dont l’anneau retient une petite gamelle d’argent.

Souper inaugural des Compagnons de la bonne table tenu à Montréal le 9 avril 1959. La Presse, 12 avril 1959, p. 6.
C’est finalement au printemps 1961 qu’est fondée à Montréal une division (ce qu’on appelle un bailliage, rappelant l’origine médiévale des confréries) de la Chaîne des rôtisseurs au Québec. Le tout premier bailli en est Rolland Douville.
Notons l’apport immense de Gérard Delage dans l’implantation des premiers regroupements gastronomiques au Québec : en plus d’être est l’un des inspirateurs du Club Prosper Montagné, des Amis d’Escoffier chapitre de Montréal, des Compagnons de la Bonne Table et de la Chaîne des rôtisseurs, il a aussi été à la source de la fondation des Gourmets du Nord, des Gastronomes amateurs de poisson, des Vignerons de Saint-Vincent et de bien d’autres encore… Une journaliste du Macleans le qualifie même de «Prince des Gourmets Canadiens». Un fascinant bonhomme, qui mériterait d’ailleurs une biographie conséquente.

Article dans le Macleans, 1er juillet 1974.
Au fil des décennies, les activités de ces associations de gastronome se développent, s’articulant de très près au monde de la restauration et de l’hôtellerie. Elle jouent un rôle important dans la maturation d’un art culinaire québécois. En effet, les grandes rencontres se tiennent dans les meilleurs restaurants, donnant l’occasion aux chefs de démontrer leur savoir-faire. Les accords mets-vins se précisent. En 1972, la Chaîne des rôtisseurs choisit Montréal pour y tenir le Congrès mondial de la gastronomie, considérant que la métropole est la «capitale gastronomique du Nouveau Monde». Rien de moins!
En 1979, selon l’article du magazine Macleans (dont vous voyez la première page ci-haut), le Québec compte 33 clubs gastronomiques officiels, cumulant plus de 1000 membres, un nombre auquel s’ajoutent tous les regroupements privés et les clubs de dégustation de vins. À ceux déjà cités, ajoutons Les Chevaliers de la Table Ronde, Les Amitiés Gastronomiques Internationales, le Club Gargantua, etc. En fait, les villes de Montréal et Québec hébergent plus de confréries gourmandes que New York, Chicago et San Francisco réunies!
Mais… car il y a un mais : ces regroupements sont alors essentiellement masculins. Le poids de la tradition, je suppose. Or, dans les années 1970-1980, la misogynie de ce milieu fait figure d’anachronisme. En guise de «représailles», certaines femmes gravitant dans le milieu de la gastronomie créent Les Néophytes du Nectar et de l’Ambroisie et quelques autres groupes exclusivement féminins. Avec le temps, les clubs finissent par ouvrir leurs portes à tous.
*

Crédit photo: Fairmont Le Château Frontenac, 2019
Qu’en est-il aujourd’hui? Est-ce que le Québec compte encore autant de confréries gastronomiques?
En fait, je ne suis pas parvenue à obtenir de chiffres probants quant au nombre d’associations de cette nature, ni au nombre de membres qu’elles rassemblent. Lors du souper d’hier soir au Château Frontenac, marquant la renaissance de la Chaîne des rôtisseurs – bailliage de Québec (dont le bailli actuel est Jean-Louis Souman), j’ai été ravie de voir l’intérêt de l’assistance, nombreuse et enthousiaste. Mais cela demeure une appréciation subjective. Si quelqu’un détient plus de détails sur l’état actuel des confréries, le nombre de membres, etc., merci de m’en faire part: je m’empresserai d’ajouter ces informations!
C’est un univers fascinant. Je ne promets rien, mais j’aimerais bien «m’attaquer» plus sérieusement aux confréries gastronomiques, y compris vineuses (chevaliers du Taste-Vin et autres Compagnons du Beaujolais). Un de ces jours.
Bises.
– Catherine